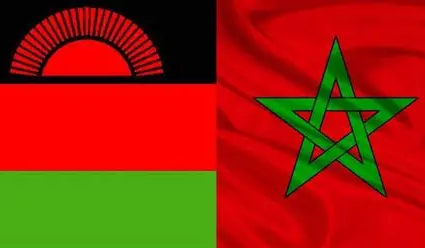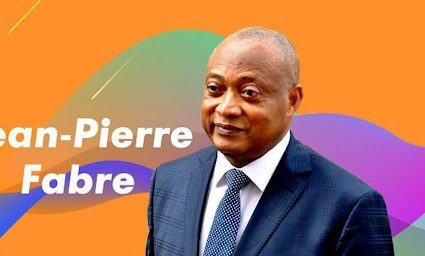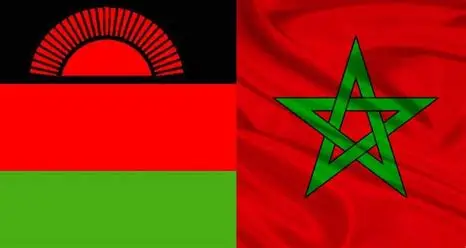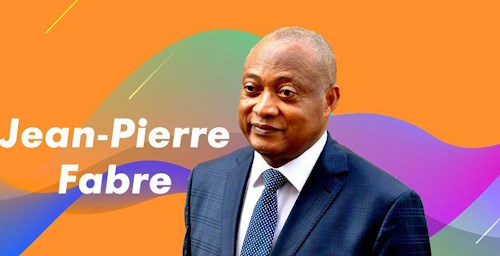La préfecture de la Kozah et ses environs virent, de cette mi-juillet jusqu’à la mi-août prochaine, les rites initiatique Evala (chez le jeune garçon) et Akpema (chez la jeune filleà. En marge de ces activités, hautement culturelles, s’organise une exposition inédite des œuvres d’Arts Plastiques réalisées sur le rituel d’initiation religieux « Akpendu » de la jeune fille Lama (peuple surnommé Kabyè) au mariage.
Placé sous le haut patronage du ministère de la Culture et du tourisme, et sous le parrainage de la commune Kozah 1, le marché des Arts du Kara, en collaboration avec Halou Kerewa Création/sac Art et Harmonie Kozah, organise la troisième édition de Expo ‘’KAR’ARTS Evala2024’’.
Dans ce numéro, parlons de la retraire, le rite de purification…
- La Retraite (Akpema su numu)
C’est le moment où la jeune fille proposée à l’initiation prend conscience du changement d’état qu’elle va effectuer par les différents rites qui la mettront en face de ses futures responsabilités conjugales et domestiques, ainsi que de sa place dans la société

Par leur présence et leur participation aux divers travaux domestiques, les kakpeisi représentent un soutien moral non négligeable pour leur aînée qui se voit contrainte par l’âge et la loi sociale de quitter la vie des adolescentes (vie de liberté) pour des tâches plus responsables dans la famille et la communauté villageoise
- Le rite de purification
Le soir de la veille de la retraite ou le matin du premier jour de la retraite, les Akpema reçoivent des scarifications sur les joues, le front et parfois sur le ventre, de nos jours sous les oreilles. C’est par ces scarifications, qui laissent souvent des caractères indélébiles, qu’on reconnaît femmes ayant subi les rites d’initiation de akpendu
Ces scarifications sont les symboles de la purification psychologique visant le changement de mentalité et d’état de vie chez les initiées. Aussi constituent-elles un objet de fierté pour les femmes qui les portent. Il n’est pas rare qu’en cas de conflits avec leurs voisines n’ayant pas subi ces rites, les femmes en tirent profit pour se moquer d’elles. Elles apparaissent aussi comme des éléments esthétiques de la beauté féminine
Le jour de la danse des Evala, elles se rendent sur les lieux de la danse, la tête couverte d’une natte en raphia ou de doum pour ne pas être vues du public et montrer aussi par ce signe que la retraite continue.
- Les rites d’intégration au rang des adultes (Ariywa)
A Somdina, la veille du sacrifice d’action de grâce en l’honneur des ancêtres (le soir de hodo lundi) chez l’oncle maternel (égbélé), Akpenu et ses kakpeisi vont dormir chez lui. Le matin de piya mardi, il offre un sacrifice de bénédiction aux ancêtres : hatetina sur une motte de terre : kumodé dans une petite case (nantèe), qui symbolise la présence de tous les ancêtres de la lignée.
L’oncle, en accueillant sa nièce, la présente aux ancêtres en leur rendant grâce de lui avoir donné une vie humaine en plus. Cette vie humaine leur appartient, elle a été accordée par eux. C’est donc leur enfant qu’il leur présente afin qu’ils l’acceptent et l’intègrent au rang des adultes et des ancêtres de la lignée, gardiens de la tradition.

Après cela on immole les bêtes. C’est au cours de cette cérémonie que Akpenu se fait raser les cheveux par son oncle. Après le repas de communion toute la viande des animaux tels que les chèvres, les moutons… immolés est remise à Akpenu qui de retour à la maison la distribuera à ses beaux-frères et belles-sœurs et aux autres membres proches ou éloignés de sa famille en signe de solidarité avec toute la classe des adultes où elle vient d’être intégrée.
La même cérémonie d’accueil et de présentation aux ancêtres pour demander leur bénédiction et leur protection est reprise par le père le jour de Cila (le mercredi), et la mère le jour de mayzay (samedi). Après ces rites chez l’oncle maternel et chez les parents, les oncles comme les parents sont heureux d’avoir accompli leur devoir envers les ancêtres qui leur ont légué ce pouvoir, et heureux aussi d’avoir initié leur enfant au culte des ancêtres.
La fin de la retraite est marquée par la manifestation solennelle des Akpema du village le jour de la fête des prémices aux environs de 17-18 juillet. C’est ce Jour-là qu’on implore dans les sanctuaires cantonaux la bénédiction de Ekolimiè sur tout le Pays Kabyè, en offrant aussi les premières récoltes de la saison : le petit mil sous forme de libations.
- La manifestation solennelle
Suivant les cantons et les villages, la sortie solennelle des Akpema (fin de la retraite) a lieu le jour de la fête des prémices, le dimanche kujuka ou au lendemain de cette fête hodo: c’est-à-dire le lundi qui se situe, avons-nous dit, vers les 17-18 juillet.
a-Préparations matinales
Dès le matin, la famille de la fiancée apprête tout ce qu’il faut pour la préparation d’un repas à porter à la famille du fiancé ; ce repas appelé kuzaliwe est composé d’une pâte, (une espèce de polenta italienne faite avec la farine de mil) qui se consomme, accompagnée d’une sauce d’arachide au poulet, fortement pimentée et salée, et contenant au moins 25% d’huile rouge faite à partir des baies du palmiers à huile. C’est un grand repas destiné à plus d’une cinquantaine de personnes. Il est accompagné d’une bête (mouton ou chèvre).
Pendant ce temps, d’autres préparatifs se font chez la fiancée. Celle-ci, (si elle est l’aînée de la famille) se rend chez son oncle maternel pour un nouveau rasage de la tête qui ensuite est enduite d’ocre rouge: payaki-i tolum.
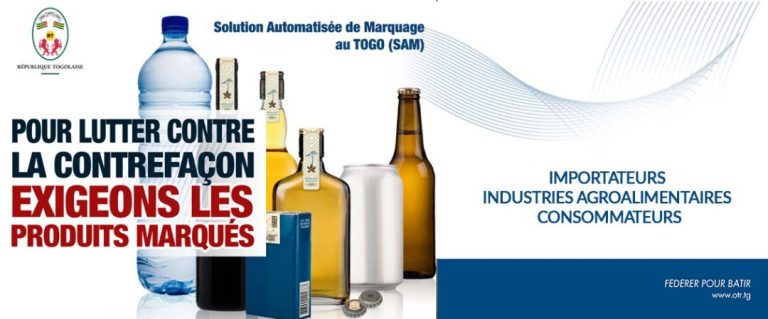
Si la fiancée n’est pas l’aînée de la famille tout se fait dans la maison de la famille paternelle. Alors, les marraines la font asseoir sur un tabouret (kpéré) au milieu de la cour intérieure de la maison et lui mettent les bracelets dits tchangbalaa au bras gauche et une bande de crinière blanche : kpem au pied droit et on lui passe sur tout le corps, de façon presque invisible, le reste de l’ocre rouge utilisée pour la tête rasée. Pour rehausser l’éclat de sa beauté, on lui fait porter des perles. Celles-ci étaient traditionnellement faites de gousses de néré enfilées dont certaines qualités étaient achetées chez les Nawdeba voisins
Depuis le développement des échanges commerciaux, (à partir du milieu du XIX siècle), avec les circuits transsahariens et atlantiques, on utilise la plupart du temps des perles de verroterie.
Ces perles sont appelées Kpatade. Les initiés portent également une autre ficelle faite de coton cimay, kpenan kpantaba, c’est la ficelle rituelle qui sera détachée chez le fiancé.
Enfin, on lui pose un anneau de fer ligbade au cou comme on fait aux kondonaa. Cet accoutrement terminé, on lui apporte le bâton pyrogravé dooka qu’elle appréciera et au besoin, refusera s’il ne lui plaît pas, jusqu’à ce qu’on lui apporte le meilleur artistiquement bien taillé.
Ce bâton qu’on dit être celui des parents, est en fait celui du fiancé. Car c’est lui qui le prépare par avance et le remet aux parents de la jeune fille. C’est pendant ces préparatifs précédents les cérémonies d’initiation que la fiancée peut avoir une dernière occasion de dire non à son fiancé en n’acceptant pas les objets rituels accompagnés de paniers de mil ; dooka molnm qu’on apporte à ses parents. Si la maman entre temps sait que sa fille a un autre prétendant qui lui fait des cadeaux en cachette, elle cherchera à ce que l’affaire soit réglée avant le moment des cérémonies. Il faut qu’elle dise qui est au juste son fiancé. Si la fiancée ne veut pas du fiancé jusqu’ici reconnu par les parents, elle ne devra pas accepter dooka mulum.
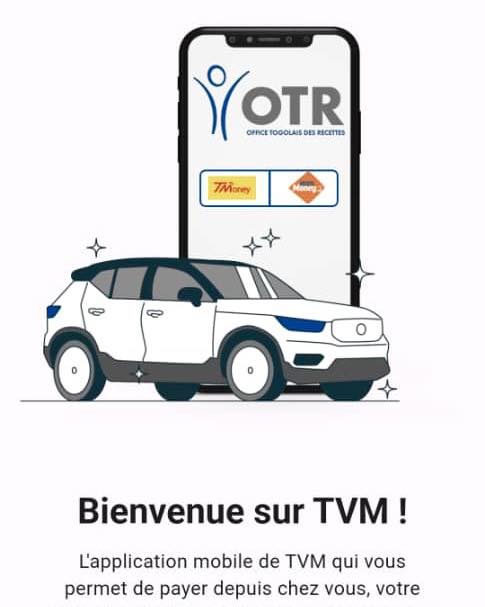
Mais si la fille ne veut rien dévoiler par crainte de réprimandes, elle ne dira rien jusqu’au jour de la rencontre au sanctuaire des vierges, où a lieu le premier échange de consentement. C’est ce matin de la préparation ultime que les marraines Kpankpamin ou maîtresses d’initiation lui apprennent comment il faut tenir le bâton pyrograve. On fait asseoir la fiancée sur un tabouret le bâton fixé entre les deux gros orteils, passe par les doigts des deux mains et monte au front incliné vers le sol. On lui passe deux tresses de cauris qu’elle porte en bandoulière.
b-La Procession vers le sanctuaire
Le départ solennel des initiées vers le sanctuaire se fait en procession à partir de leurs maisons respectives, pour se retrouver toutes ensemble au sanctuaire. Elles sont accompagnées de leurs maîtresses d’initiation et de leurs assistantes, auxquelles s’ajoute une foule de sympathisantes. Les solistes entretiennent le climat de joie et de fête par des chants de louange exaltant la beauté physique de la jeune fille parée de ses bijoux, comme pour rehausser la valeur de sa jeunesse de sa virginité juvénile jalousement et fièrement gardée pour son futur époux, les solistes ne cessent de décrire tout ce qu’on peut constater.
Pour leur éviter des mimiques d’où qu’elles viennent, et des sourires que provoqueraient les grimaces des observateurs, on leur met du cure-dent à la bouche, bâton ðórogravé à la main droite qu’elles garderont pendant toute la période des initiations. Elles avancent d’un pas rapide vers le sanctuaire dont les portes leur sont ouvertes officiellement pour la première fois en présence des ancêtres et de Ekolimiè.
- Le rite de présentation
Les jeunes filles enceinte et les filles-mères n’ont pas accès à ces lieux, on leur fait une cérémonie de présentation symbolique à part. On les fait passer derrière le sanctuaire, c’est à-dire que les non – Vièges ont leur cérémonie en dehors du sanctuaire ». L’entrée des filles-mères dans le lieu saint, dit-on, provoque la colère des ancêtres qui envoient les abeilles sur la foule et des calamités naturelles : sécheresse, inondations …

Dans le sanctuaire, une des maîtresses d’initiation accrédité à cette fonction reçoit les Akpema l’une après l’autre dans un hémicycle de pierres, elle saisit chacune par les aisselles, la fait s’asseoir puis la soulève pendant qu’une autre ayant en main les feuilles d’une plante de kaluka purifie le siège, le même geste est répété trois fois. Quand la fiancée est définitivement assise on lui donne à boire de la bouillie ou de l’eau dans laquelle on a délayé de la farine de mil qu’une autre marraine portait depuis la maison dans un petit pot. Elle fait semblant de boire. Mais n’en boit pas, c’est un geste symbolisant l’accueil dans la maison des ancêtres.
- Rite du libre consentement de la fiancée
Les parents retirent à la fiancée assise le bâton pyrogravì dooka qu’elle tenait depuis la maison. Dans ce sanctuaire se trouve le groupe des prétendants inconnus et celui des membres de la famille du fiancé.
Un membre de la famille du fiancé vient présenter le dooka de la famille. Si la fiancée est constante, elle reçoit le dooka de son fiancé attitré ou le refuse pour recevoir celui d’un autre prétendant qu’elle veut épouser.
En recevant le bâton pyrogravé de son fiancé, elle marque officiellement qu’elle le prend pour époux. Tandis que choisir celui d’un autre prétendant signifie sa préférence pour ce dernier, mais ce choix entraîne des conséquences graves que la mère de akpenu voulait éviter en cherchant à savoir d’avance si sa fille ne préferait pas un autre prétendant. Le choix de dooka par akpenu confirme ou révèle qui est son vrai fiancé. Après le rite du libre consentement de la lancée, la cérémonie se poursuit à un autre endroit par celui de l’épreuve de virginité.
- Le contrôle de l’état de virginité
A Soutè, ce lieu est un peu en retrait du sanctuaire. Il s’agit d’une pierre sacrée dite milaa piè « pierre des fornicatours ».
Dans d’autres sanctuaires comme liuyoo à Somdina c’est une hutte avec une petite entrée juste pour le passage d’une tête.
A ce niveau toute initiée ayant déjà connu un garçon ne doit pas s’avancer, elle s’assied au contraire sur une pierre à côté mais non sur la pierre sacrée. On se moquera d’elle mais la moquerie n’ira pas au-delà de l’évènement, car on lui reconnaît sa franchise et son sens du sacré qui consiste à ne pas provoquer d’avantage la colère des ancêtres, l’initiée qui, malgré sa non-virginité se hasarderait à s’asseoir sur la pierre sacrée est châtiée sur place par une sorte d’hémorragie (Esotu) que tout le monde amené à constater. Cet événement n’est jamais oublié car on cherchera à connaître ses parents et sa famille et on en parlera aussi longtemps que les gens se souviendront.

Les mêmes exigences sont observées pour le cas du passage par le trou de la case. Seules les vierges peuvent y rentrer. Les non- Vierges sont coincées en s’y hasardant. C’est ici que se vérifie la virginité de la jeune fille tant exaltée par la soliste pendant la procession. De cette épreuve, les initiées qui sont reconnues vierges sont accueillies avec des cris d’acclamation par leur famille et celle du fiancé. Les uns se réjouissent de la réussite de leur éducation et les autres d’avoir pour épouse une jeune fille modèle par sa fidélité à son époux.
Accueillie avec acclamation par la famille du fiancé, et ses alliées, la fiancée est introduite avec ses kakpeisi chez le fiancé appelé à son tour à donner son libre consentement
f- L’accueil dans la maison du fiancé: rite du libre consentement du fiancé
En sortant du sanctuaire la jeune fille se rend à la maison du fiancé. Cette visite officielle marque son consentement ratifié au sanctuaire. C’est parmi les chants d’allégresse qu’elle y est introduite avec les membres de sa famille qui l’accompagnent. On dit alors : akpema kpema pètè : les initiées sont rentrées chez elles ; la maison du fiancé devient désormais la maison de sa fiancée. La fiancée est accueillie à l’entrée de la maison par le chef de famille. Celui-ci sort avec un poussin qu’il présente à akpenu qui refuse le présent en disant que c’est trop grand : may-caa pýsýna pikila-m paylu.
Le chef de la famille va chercher un poulet qu’elle n’appréciera pas d’avantage ; le même jeu se répète jusqu’à ce qu’on lui apporte un gros coq qui lui plaise. C’est alors qu’elle est introduite dans la maison où va se dérouler le rite d’engagement du jeune homme qui accepte de la prendre pour femme. Quant au coq il est immédiatement tué, tapé contre le sol ; dans d’autres localités il est tué le lendemain matin.
g- Le rite de consentement est présidé par les femmes de la maison au nom du fiancé
Une maîtresse d’initiation de cette maison coupe à la fiancée la ficelle rituelle qu’elle porte aux hanches ; une autre lui lave l’ocre rouge de la tête. Le tout est déposé soigneusement dans un récipient. Ce rite montre que désormais elle appartient totalement à son mari en tant que sa femme. Par ce rite la jeune fille et le jeune homme sont liés pour toute la vie et ne doivent plus se séparer. Ce soir-là elle dormira avec ses assistantes dans une seul case, ne mangera rien jusqu’au matin.
Le lendemain matin, la jeune fille initiée et ses assistantes vont chercher des feuilles vertes de sorgho ou d’autres plantes pour le bétail qui est retenu par les cordes dans la cour pour les empêcher de détruire les champs.

A leur retour on met à leur disposition un pot de boisson, pendant qu’on prépare le repas de circonstance qui clôturera leur séjour chez le fiancé. Les visiteurs aussi ont leur boisson à part. A la fin du repas de circonstance, on donne à akpenu quelques estagnons de mil, de noix de palme, de grains de baobab décortiqués : cudum, du piment, du sel… en plus de la pâte préparée une marmite de sauce d’arachide bien pimentée et condensée d’huile rouge. La poule ayant servi à l’accueil de la veille, est préparée au cours de ce repas, mais ne sera consommée qu’après leur retour à la maison paternelle.
En plus ces dons, il faut noter parfois le don d’une ou de deux bêtes (mouton ou chèvre) et d’une poule respectivement destinées aux parents et à l’oncle maternel. La ficelle rituelle kpenan coupée la veille et l’ocre rouge lavée de sa tête, sont ramenées à la maison avec l’ensemble des dons offerts par la famille du fiancé à la fiancée. Le mil servira à la préparation de la boisson de la fête de kýyènna trois semaines après, vers les 8-9 août, et les amandes de palme pour faire de l’huile en vue des beignets à préparer à cette occasion, de même que tous les autres condiments. Si la fiancée revenait chez son fiancé avant la date du mariage, elle est autorisée à y prendre part au repas, en vertu de cette cérémonie d’accueil officiel qui a fait d’elle la femme de la maison. La jeune fiancée est intégrée dans la concession familiale de son futur époux et elle s’y sent chez elle.
Revenues à la maison paternelle, akpenu et ses assistantes se donnent à des activités domestiques et champêtres. Dans une ambiance de fête, les kakpeisi exécutent des chansons populaires qui attirent les garçons après le repas du soir; c’est une occasion pour certains de se faire des amies parmi les kagbeýsý, quitte à en faire des fiancées, sur accord des parents des deux amis.
La période d’initiation des jeunes filles, constitue un moment privilégié où jeunes gens et jeunes filles peuvent jouer ensemble, et se choisir des fiancés. Dans ces rencontres nocturnes au vu et au su de tout le monde les kagbeýsý sont solidaires contre toute agression sexuelle éventuelle d’un garçon qui ne chercherait que l’assouvissement de ses instincts immédiats.
Le rôle de akpénu à ce moment est d’être vigilante pour protéger ses assistantes, car en fait, elle est pour ses kagbeýsý une sœur aînée dont on attend protection. Son comportement envers elles doit être celui d’une mère. Et la joie de celle-ci leur vient de cette attitude maternelle de akpenu. Sa vigilance doit être accrue d’autant plus qu’il y a des « Don Juan» qui essaient de s’infiltrer dans la case commune pendant que les kagbeisi dorment. Il n’est pas rare que l’initiée soit aidée dans cette garde par un garçon d’honneur déjà initié évalu, appartenant à la famille de son fiancé. Dans ce climat de respect de soi et de l’autre, un garçon surpris en flagrant délit au milieu des filles est rossé par celles-ci sans souci de blessures.

Une fille surprise en flagrant délit avec un garçon à l’intérieur de la case ou en dehors est mal vue de ses camarades qui se moquent d’elle par des chansons satiriques. Les rencontres fraternelles d’échanges et de joie sont en honneur mais pas l’immoralité. Puis les cérémonies d’initiation après trois semaines de vie au ralenti, reprennent leurs activités pour la dernière étape vers les 9-10 août, avec la fête de kýyenna.
(In CHRONIQUE DE LA SEMAINE n°719 du 11 Juillet 2024)
E-mail : maciteinfo@gmail.com; bawela1@gmail.com
Pour vos annonces, (publi)reportages, etc., joignez-nous au (00228)91515309/79872224 www.macite.tg, L’information, la bonne !